- PSYCHOPHYSIOLOGIE
- PSYCHOPHYSIOLOGIELa psychophysiologie est l’étude des mécanismes physiologiques par lesquels s’accomplit le comportement de l’homme et des animaux. Une telle définition recouvre des conceptions scientifiques et des approches méthodologiques parfois très dissemblables: la psychophysiologie est née et s’est développée sous l’impulsion de chercheurs provenant d’horizons scientifiques fort éloignés les uns des autres; d’autre part, l’étude du comportement et de ses relations avec la physiologie implique nécessairement des options d’ordre philosophique, dont le caractère est éminemment fluctuant; enfin, les techniques physiologiques classiques ne paraissent plus être les seules auxquelles le psychophysiologiste puisse faire appel, de nombreuses autres disciplines, la psychopharmacologie ou la neurochimie par exemple, ayant également contribué au prodigieux essor de la psychophysiologie contemporaine.Entre la psychologie et la physiologieSituée au carrefour de la psychologie et de la physiologie, la psychophysiologie a souvent été considérée à cause de cela comme ayant un statut imprécis et un peu hybride, d’autant plus que le psychologue et le physiologiste ont à son propos des conceptions méthodologiques parfois très différentes. La psychologie, qui est la science du comportement et dont l’objet d’étude est essentiellement l’être vivant aux prises avec son milieu environnant, s’appuie sur les grandes catégories fonctionnelles du comportement et cherche à en compléter la description par la mise en évidence de leurs accompagnements organiques. Le but de certains psychologues, qu’on devrait appeler physiopsychologues ou neuropsychologues, est souvent moins d’établir des rapports de cause à effet que de construire une phénoménologie du comportement envisagé dans sa globalité psychosomatique. D’autres, par contre, ne s’arrêtent pas là et tentent, à partir d’observations du comportement tel qu’on peut le saisir dans la nature (éthologie) ou l’influencer en laboratoire (psychologie expérimentale), de chercher, comme le pose en principe Morgan (1943), quels sont les mécanismes physiologiques qui sous-tendent les formes traditionnelles du comportement, ces entités qu’on dénomme instinct, complexe, émotion ou intelligence. Comme le fait remarquer A. Fessard (1959), une telle psychologie physiologique, dans son effort de synthèse, ne pourrait s’opposer, semble-t-il, à ce qu’un clivage s’opère parmi les psychologues, entre ceux qui s’allient d’une manière ou d’une autre avec la physiologie et ceux qui font porter tous leurs efforts sur l’influence des facteurs sociaux sur le comportement, clivage compréhensible et déjà effectif mais bien regrettable et que devrait normalement atténuer l’évolution ultérieure des sciences biologiques.Quant à la physiologie traditionnelle, et surtout la neurophysiologie – science des fonctions de relation – , elle ne se désintéresse certes pas des interactions entre l’organisme et son environnement, mais ses préoccupations se situent cependant surtout au niveau du fonctionnement des organes nerveux, qu’elle tâche de contrôler étroitement afin d’en déduire des lois aussi précises que possible. Aussi n’est-il pas étonnant que le neurophysiologiste, pour qui cette conception un peu étroite ne paraît guère satisfaisante, se sente de plus en plus souvent attiré par l’étude des interactions entre l’individu et son milieu et s’efforce de l’inclure dans le cadre de la neurophysiologie, laquelle deviendrait ainsi une psychophysiologie. Pour certains chercheurs, cette psychophysiologie doit s’efforcer de confronter mécanismes psychologiques et physiologiques dont les niveaux d’intégration sont très éloignés les uns des autres et dans une certaine mesure irréductibles. Pour d’autres, par contre, Pavlov en est un exemple, il n’y aurait entre la physiologie et la psychologie que des différences de degré et non de nature, tout comportement devant s’expliquer en fin de compte par le seul jeu, parfaitement prévisible en fonction des modifications de l’environnement, des relations coordonnées entre les différents organes.Ces deux voies d’approche, issues respectivement de la psychologie et de la physiologie, ont chacune fortement contribué à améliorer la connaissance des bases physiologiques du comportement; mais un sérieux effort d’épistémologie est nécessaire en vue de donner à la psychophysiologie un statut qui lui soit propre, à l’abri d’excès doctrinaires de toute origine.Options philosophiquesLes aspects multiples que peut revêtir la psychophysiologie ne s’expliquent pas seulement par la voie d’approche utilisée – psychologie ou physiologie –, mais également par la diversité des postulats et des options d’ordre philosophique auxquels on se réfère. Faute de pouvoir faire ici l’historique de la psychophysiologie (Davis, 1958; Canguilhem, 1968), il suffira de rappeler qu’au IIe siècle Galien avait établi que c’était le cerveau et non le cœur qui était l’organe de la sensation et du mouvement, après quoi de nombreux siècles passèrent sous le signe de la théorie des « esprits animaux », jusqu’à l’avènement de l’électrophysiologie à la fin du XVIIIe siècle. Au cours du XIXe siècle, de nombreux chercheurs tels que le physiologiste Helmholtz, le psychologue Wundt et le philosophe Lotze estimaient chacun qu’à tout comportement ou état de conscience devait correspondre un état spécifique des fonctions nerveuses centrales. Seulement, l’accord était loin de se faire quant à la nature du lien entre les états de conscience et ces fonctions – la controverse, qui n’est pas près de s’éteindre, est connue sous le nom de problème du parallélisme psychophysiologique. Certes, il ne s’agit pas ici de traiter ce dernier en termes de relation « corps-esprit », car parler d’esprit revient le plus souvent à substantifier la conscience et donc à préjuger de la solution (Piaget, 1967). Le problème qui a préoccupé de nombreux philosophes et épistémologues était plutôt de savoir s’il y a interaction causale entre la conscience et les processus nerveux correspondants, ou bien s’il s’agit de deux séries parallèles de phénomènes hétérogènes, ne pouvant donc pas agir les uns sur les autres. Dans une importante analyse de ce problème, Piaget montre qu’aucune de ces deux solutions n’est tout à fait satisfaisante: en effet, la solution interactionniste ne permet pas d’imaginer quels pourraient être la nature du lien de causalité et le point d’impact des influences mutuelles provenant de la conscience et des structures nerveuses; si l’on adopte la solution paralléliste, en revanche, la conscience ne serait plus que le reflet subjectif des activités nerveuses, et l’on ne comprendrait plus à quoi elle pourrait encore servir, puisque les activités nerveuses suffiraient à tout. Pour Piaget, le fait que la complexification des conduites s’accompagne d’une extension et d’une organisation de plus en plus raffinée du champ de la conscience doit inciter à rechercher en quoi cerveau et conscience, bien que n’ayant pas d’interactions causales, sont néanmoins complémentaires, la solution étant probablement à rechercher, d’après cet auteur, dans un « isomorphisme (correspondance des structures, abstraction faite des contenus) entre les systèmes matériels d’ordre causal – cerveau et milieu – et les systèmes implicatifs de signification – la conscience ».Pour Henri Piéron, grand pionnier de la psychophysiologie moderne, cette science devrait pouvoir se développer en écartant tout recours à la subjectivité consciente, sinon à ses extériorisations comportementales, verbales ou autres: position proche de celle de l’école américaine fondée par Watson et connue sous le nom de behaviorisme.Approche phylogénétiquePour le psychophysiologiste, le comportement humain – avec ses volets perceptuel, moteur et cognitif – a une histoire qui plonge loin dans le passé des Vertébrés ; et il est clair, pour lui, que l’apparition, chez l’homme, de comportements structurés par le langage survient au terme d’une pression évolutive, qui a été agissante tout au long de la phylogenèse, et d’une sélection d’activités cérébrales de mieux en mieux adaptées pour la survie. Il est donc légitime, à ses yeux, de rechercher dans l’éventail des comportements humains, y compris ceux qui sont structurés par le langage, des niveaux de complexité reflétant la longue histoire de l’évolution du comportement chez les Vertébrés. On pourrait distinguer ainsi, chez l’homme, plusieurs niveaux correspondant respectivement à diverses étapes de l’évolution cérébrale et mentale des Vertébrés, ce qui permettrait de mieux saisir leur signification biologique et leur substrat neurologique, tout en n’oubliant pas que ces différents niveaux de complexité sont hiérarchiquement coordonnés en un tout qui a son existence et sa signification propre irréductible à la somme de ses parties.L’évolution mentale des Vertébrés s’effectue en plusieurs stades successifs qui, selon J. Altman, pourraient être ramenés à trois niveaux: pathique, iconique et noétique. Le niveau mental pathique , présent chez les poissons, les reptiles et les amphibiens, inclurait les sensations affectives de plaisir et de déplaisir, ainsi que les perceptions émotionnelles qui en découlent – douleur, colère, effroi, etc. – lorsque l’animal est confronté avec des situations inhabituelles agressives. Le deuxième niveau mental, appelé iconique , se développe essentiellement chez les mammifères en relation avec la complexification des voies sensorielles et des aires corticales indispensables pour l’analyse et l’association des informations provenant des organes des sens. À ce niveau apparaissent des perceptions sensorielles de plus en plus précises, qui élaborent mentalement un « modèle » de l’environnement et permettent l’abstraction éventuelle de détails significatifs des objets extérieurs. Apparaissent également les mécanismes mnémoniques grâce auxquels les perceptions se construisent et s’affinent en fonction de l’expérience antérieure, et grâce auxquels les images – souvenirs utilisés comme « incentifs » ou « expectations » (Tolman) – facilitent l’acquisition de conditionnements opérants, ce qui augmente évidemment l’autonomie de l’animal.Le troisième niveau mental est qualifié de noétique ou conceptuel et paraît spécifiquement humain. Le pouvoir d’abstraction et de généralisation, déjà présent au niveau pathique et iconique, est une condition nécessaire mais non suffisante pour la formation de concepts. Dans la conceptualisation, en effet, l’attention se porte d’un aspect de la perception à un autre, en termes de catégories, de principes ou d’hypothèses, afin de classer l’objet de cette perception dans un ensemble déterminé, éventuellement symbolisé par un mot. Ainsi verbalisés, les concepts alimentent alors la réflexion, laquelle inversement peut créer des concepts nouveaux communiqués à d’autres individus sous forme de langage ; cependant, le lien entre concept et langage n’est peut-être que secondaire, car bien des idées paraissent traverser notre champ de conscience sans avoir nécessairement de support verbal; et il est remarquable de constater que, tout au long de son histoire, la philosophie oscille entre une conception dualiste d’après laquelle « il faut aller aux choses mêmes, sans les mots » (Platon, dans le Cratyle ) et une conception uniciste telle que la conçoit de Saussure, pour qui le signe est un phénomène à double face qui oppose et relie un signifiant (vocal, écrit ou gestuel) à un signifié corrélatif, celui-ci n’étant pas une entité extralinguistique, mais tout simplement la contrepartie du signifiant. La position des philosophes du XIVe siècle est nuancée et singulièrement proche des idées du XXe siècle, puisque, pour eux, « la pensée conceptuelle ne serait pas un simple résultat de l’expérience sensible, mais elle dégagerait les formes abstraites, les Universaux, de la gangue sensible qui les enveloppe » (P. Ricœur). Par conséquent, si le propre de l’homme, grâce au niveau mental noétique qu’il a atteint, est sans doute de savoir qu’il existe en tant que personne, et d’avoir développé le merveilleux outil de pensée personnelle et de diffusion culturelle qu’est le langage, ce qui le distingue encore plus fondamentalement de l’animal est de savoir que le langage n’exprime qu’une partie de la réalité qu’il porte en lui. Cela peut, d’ailleurs, mener l’homme à un sentiment d’étrangeté et même d’aliénation qui se traduira éventuellement par toutes sortes d’attitudes mentales et d’expressions gestuelles religieuses ou artistiques, telles que la danse ou la musique, à moins que l’aliénation perçue soit d’une intensité telle qu’il n’y ait plus de refuge que dans la maladie mentale.En résumé, il y aurait pour le psychophysiologiste trois moments importants dans l’évolution phylogénétique des comportements. Au niveau mental pathique correspondraient des comportements permettant à l’animal de réagir de façon adaptée à ses expériences mentales de type affectif, motivationnel et émotionnel: comportement motivé alimentaire ou sexuel, prédation, chasse, agression ou, au contraire, défense ou fuite; l’animal dispose, à ce niveau, d’un diencéphale bien développé, ainsi que de structures striées et limbiques. Au niveau iconique, ces dernières structures se développent et le néo-cortex fait son apparition: les comportements se développent parallèlement et permettent à l’animal, grâce à l’épanouissement de ses fonctions perceptuelles, de complexifier ses comportements exploratoires et, par conséquent, d’enrichir ainsi son répertoire de conduites apprises; l’animal accroît son habileté motrice et on voit même apparaître chez le singe supérieur, grâce à la richesse des ses associations sensorielles soutenues par des processus mnémoniques accrus, une incontestable compétence technique. Au niveau noétique enfin, surviennent les comportements structurés par le langage et le langage lui-même; l’habileté manuelle permet l’éclosion de techniques instrumentales, et l’on utilise le terme « dextérité » comme pour souligner le lien privilégié chez le droitier entre l’habileté de la main droite et les performances verbales, toutes deux dépendant généralement d’un seul hémisphère cérébral spécialisé.L’homme se distingue sans conteste des autres Vertébrés par son niveau mental conceptuel, mais les acquis phylogénétiques antérieurs sont loin d’être entièrement perdus pour lui, plusieurs de ses comportements faisant davantage songer à un niveau pathique ou iconique. Il ne faudrait cependant pas croire ici que les comportements humains ne relèveraient nécessairement que d’un seul niveau à la fois – pathique, iconique ou noétique –, comme si ces trois niveaux s’étaient succédé au cours de l’évolution animale par simple superposition sans interaction ni hiérarchie. On sait, en effet, que les fonctions nerveuses nouvelles apparaissant au cours de l’évolution animale transforment souvent profondément les fonctions nerveuses préexistantes, telles qu’on peut les étudier dans des formes animales moins évoluées. Le sourire du singe supérieur, par exemple, qui est de la part de ce dernier un signe rassurant et pacifiant pour son congénère, peut se retrouver comme tel chez l’homme et cependant exprimer, chez ce dernier, des sentiments parfois différents et liés à son niveau mental noétique, tels qu’ironie, méchanceté ou duplicité.En tenant compte des réserves ci-dessus, le psychophysiologiste peut donc distinguer chez l’homme plusieurs types de comportements: des comportements qui expriment des émotions ou répondent à des motivations élémentaires; des comportements plus complexes reposant sur des intégrations polysensorielles; enfin, des comportements élaborés, structurés ou non par le langage. À ces divers niveaux correspondent par ailleurs respectivement des structures cérébrales d’élaboration de plus en plus récentes sur le plan phylogénétique.Neurosciences et psychophysiologieSans se substituer le moins du monde à l’approche phylogénétique dont on vient de voir tout l’intérêt, le mouvement contemporain des neurosciences a le mérite de répondre au besoin croissant d’interdisciplinarité de la part de tous ceux qui étudient les mécanismes cérébraux des comportements, et qui proviennent souvent d’horizons méthodologiques très différents. Le succès des neurosciences et l’essor considérable qu’ont donné celles-ci à la psychologie s’expliquent essentiellement par le fait que les chercheurs ont réalisé que l’étude du cerveau à un niveau donné de complexité – neuronique, par exemple – est de peu de secours pour la compréhension du cerveau et du comportement si les résultats de cette étude ne sont pas confrontés à ceux qui sont obtenus à des niveaux différents de complexité – population de neurones, réaction motrice, comportement complexe.Les neurosciences n’auraient cependant pas atteint le niveau d’efficacité qu’on leur connaît aujourd’hui s’il n’y avait pas eu, parallèlement, d’importantes recherches dans le domaine de l’épistémologie des sciences. La théorie des systèmes, notamment, établit le principe d’émergence, d’après lequel un système possède des propriétés « émergentes » que ses composants n’ont pas. Un système – une population de neurones, par exemple – possède un degré de complexité plus grand que ses parties – les neurones – et possède donc des propriétés irréductibles à celles de ses composants. Cette irréductibilité doit être attribuée à la présence des relations qui unissent les composants (J. Ladrière). La théorie des systèmes permet de placer l’homme à un certain niveau d’une hiérarchie de systèmes superposés d’une complexité croissante d’un niveau à l’autre, depuis les atomes constituant le cerveau jusqu’à la société dans laquelle il se regroupe avec d’autres hommes. L’homme est un système bio-psycho-social (Bunge) dont la spécificité est de posséder conscience réflexive et langage, et dont le niveau d’intégration est situé entre le biologique et le sociologique. Le chercheur doit, par conséquent, toujours identifier le niveau hiérarchique où se déroule sa démarche expérimentale, en se rappelant que le système qu’il étudie est émergent par rapport aux sous-systèmes qui le constituent, et qu’il fait lui-même partie d’un système émergent situé à un niveau supérieur. À condition de ne pas verser dans un réductionnisme hâtif ou une démarche d’intégration prématurée, cette approche systémique a un grand pouvoir explicatif: il suffit de rappeler, par exemple, une découverte classique en psychophysiologie, telle que le rôle des noyaux du raphé bulbaire dans le déclenchement du sommeil et celui de la sérotonine, médiateur synaptique des neurones constituant ces noyaux.Il reste cependant une difficulté que ne semble pas rencontrer la théorie des systèmes et à laquelle le psychophysiologiste demeure confronté: dans la hiérarchie des systèmes émergents, depuis le neurone jusqu’à la société humaine, il y a un point de rupture que le seul concept d’émergence n’éclaire que d’une manière insuffisante; il s’agit des niveaux que représentent le cerveau et le langage. Dans cette version contemporaine du vieux problème corps-esprit, se trouve en effet le paradoxe suivant: il est vrai que le langage est émergent par rapport au cerveau et possède donc des propriétés que le cerveau n’a pas; cependant, à moins de retomber dans l’erreur du vitalisme, il est impossible d’admettre l’émergence à partir du cerveau (régi par des causalités physico-chimiques) de la conscience réflexive et du langage (qui sont régis par des implications d’ordre logique) sans postuler quelque chose de commun dans les structures respectives des mécanismes cérébraux et du signifié linguistique. S’il est vrai qu’à toute pensée correspond un certain état de l’activité cérébrale, l’émergence d’un monde où règnent la logique et l’herméneutique à partir d’un monde régi par des explications physico-chimiques doit nécessairement s’accompagner d’un certain isomorphisme, au sens où l’entend Jean Piaget, entre ces deux mondes.Techniques expérimentalesLa diversité des options possibles en psychophysiologie apparaît très clairement aussi lorsqu’on passe en revue les diverses techniques expérimentales qui sont à la disposition du chercheur.Le psychophysiologiste, soucieux de descriptions phénoménologiques, fait essentiellement usage des techniques d’enregistrement et tâche de relier l’indice physiologique – électro-encéphalographique, respiratoire, cardio-vasculaire, électrodermal... – au comportement. Celui qui a des préoccupations plus ambitieuses et plus spécifiques, à savoir « relier l’indice au mécanisme physiologique responsable de la réaction comportementale de l’organisme » (Paillard, 1966), utilisera pour sa part les indices physiologiques, y compris les plus raffinés (ainsi l’activité de neurones uniques enregistrés au moyen de micro-électrodes), dans une perspective non point descriptive mais explicative, et, à cette fin, il se servira des diverses techniques lui permettant d’influer sur le comportement de l’animal: apprentissage, administration de drogues, destructions localisées du système nerveux central, stimulation électrique ou chimique intracérébrale permettant d’activer ou d’inactiver des régions limitées du cerveau.Il faut remarquer que, pour l’essentiel, les connaissances en psychophysiologie ont été acquises grâce à l’expérimentation sur des Vertébrés supérieurs, tels des chats ou des singes, et ne doivent souvent être extrapolées à l’homme, dont l’étude psychophysiologique par expérimentation intracérébrale ne fait que commencer, qu’avec beaucoup de prudence. De très importantes recherches ont cependant été faites également chez des animaux inférieurs tels que des Invertébrés, ces préparations plus simples permettant l’étude concomitante de comportements élémentaires et de réactions synaptiques ou neuroniques, et, par là, une approche fondamentale des mécanismes psychophysiologiques. Ces tentatives qui recherchent dans les comportements élémentaires d’Invertébrés des « modèles » en vue de mieux comprendre les mécanismes qui conditionnent les comportements plus complexes d’animaux supérieurs sont d’ailleurs à l’origine de l’éclosion d’une psychophysiologie théorique qui se donne pour mission, souvent avec l’appui d’expérimentation sur les animaux, de créer, au moyen de réseaux électroniques et de méthodes logiques diverses, des modèles analogiques du fonctionnement nerveux.Signalons enfin l’apport au développement récent de la psychophysiologie de nombreuses autres disciplines: l’éthologie animale et humaine, la génétique, la neurochimie, la psychopharmacologie, l’ionophorèse au moyen de microélectrodes, l’étude électrophysiologique sur culture de tissu cérébral ou tranches de cerveau maintenues vivantes en milieu nourricier artificiel. Dans tous ces cas, le progrès obtenu découle essentiellement du dialogue établi entre spécialistes de disciplines de niveau différent: généticien, neurochimiste, électrophysiologiste et psychologue expérimental, par exemple. Une mention spéciale doit être faite ici des progrès réalisés dans le domaine des modèles obtenus grâce à l’interaction constante entre données théoriques et expérimentales: modèles de la perception visuelle (Marr) ou des mécanismes qui sont à la base de l’oculomotricité (Robinson), issus les uns et les autres de la collaboration entre ingénieurs, électrophysiologistes, psychologues et neurologues. Parmi les méthodes dont dispose le psychophysiologiste, il faut citer enfin la tomographie par émission de positrons, qui permet d’objectiver, au cours d’une tâche imposée au sujet, des aspects essentiels du métabolisme de son cerveau: grâce à cette technique, il a été possible, par exemple, d’objectiver le fait que, durant une tâche de lecture silencieuse, certaines aires du cortex cérébral consomment plus de glucose que d’autres, et qu’il s’agit essentiellement des aires qui sont en relation avec la compréhension du langage écrit et de celles qui sont impliquées dans la motricité sous-jacente au mouvement nécessaire à l’émission verbale.Mécanismes cérébrauxLe psychophysiologiste d’aujourd’hui s’attache probablement moins que ses prédécesseurs à définir les principes philosophiques de ses recherches, non qu’il dénie toute importance à ce type d’option, mais parce qu’il se préoccupe davantage d’établir « dans l’ensemble des faits qu’il étudie des structures de relation qui le conduiraient à des rapprochements unificateurs dont l’essentiel survivrait aux changements des systèmes philosophiques » (Fessard, 1959). Il n’est donc pas très étonnant que l’étude des modes d’articulation entre les aspects psychologique et physiologique du comportement se soit cristallisée progressivement en un problème qui domine tous les autres: celui de la localisation cérébrale des fonctions psychologiques. Depuis Broca, qui publia en 1861 son célèbre travail sur la localisation, au niveau de l’hémisphère gauche, des centres du « langage », on vit naître des théories prônant, pour expliquer l’acquisition de nouvelles conduites, l’« action de masse » de l’ensemble du cortex cérébral (Lashley, 1931) ou, au contraire, la spécificité de régions parfois très limitées de l’aire corticale (Konorski, 1967). Cette controverse sur le caractère diffus ou localisé des mécanismes cérébraux conditionnant le comportement a également servi de toile de fond à l’étude d’autres fonctions psychologiques telles que la mémoire, l’affectivité, les comportements instinctifs; mais il semble qu’à la lumière de travaux plus récents, électrophysiologiques ou réalisés au moyen du tomographe à positrons, ces deux conceptions qui semblent opposées apparaissent comme réellement complémentaires, en ce sens que, dans la genèse d’un comportement donné, l’intervention de régions spécialisées du cerveau semble tout aussi indispensable que celle de l’activité cérébrale globale.On se rend compte cependant que le problème des localisations fonctionnelles, malgré tous les progrès qu’il a permis de faire, risque fort, s’il n’était pas mieux posé, de constituer un certain frein à l’essor futur de la psychophysiologie. Il faudrait se demander, par exemple, si l’articulation entre les aspects psychologiques et physiologiques du comportement ne devrait pas être étudiée au moyen de méthodes bien plus subtiles, dans lesquelles l’accent serait mis sur les caractéristiques temporo-spatiales et non seulement spatiales de l’activité cérébrale. Cette approche méthodologique rejoindrait peut-être ainsi la théorie des localisations dynamiques de Luria (1966), pour qui le cerveau fonctionne « comme un tout, animé par une constellation de populations neuroniques pouvant se grouper en configurations fonctionnelles spécifiques ».On pourrait se demander également si les catégories habituelles utilisées dans l’étude du comportement sont à reprendre telles quelles au niveau des fonctions nerveuses: ainsi, de nombreux travaux ont démontré la stérilité de l’usage des termes psychologiques habituels pour décrire les symptômes complexes observés après lésion cérébrale; en outre, comme l’a suggéré Fessard (1969), la succession classique des trois étapes distinctes – perception, décision, ordre moteur – ne constitue pas un modèle très utile en ce qui concerne le système nerveux, où une partie de la décision paraît déjà s’effectuer au niveau des synapses sensorielles les plus périphériques et où la perception elle-même telle qu’elle résulte des mouvements d’un œil ou du corps est conditionnée par les ordres moteurs à l’origine de ce mouvement (Teuber, 1971).Quoi de plus compréhensible, par conséquent, que de nombreux psychophysiologistes actuels recherchent les principes de l’organisation nerveuse non dans un système de réseaux dont l’organisation serait calquée sur celle des catégories psychologiques habituelles, mais dans des systèmes connexionnistes plus complexes où interviennent des processus relevant de conceptions probabilistes!Le statut de la psychophysiologieOn pourrait se demander si le caractère un peu disparate de la psychophysiologie ne fait pas de cette dernière un terrain d’étude particulièrement instable où ne devraient s’avancer qu’avec réticence psychologues et physiologistes. Une telle crainte apparaît cependant peu raisonnable si l’on songe que les mécanismes essentiels étudiés respectivement par ces deux groupes de chercheurs sont, « par le jeu des régulations organiques et de l’adaptation au milieu, au service de ces grands impératifs: maintien et propagation de la vie » (Fessard, 1959). La psychophysiologie se trouve par conséquent devant une tâche qui lui est tout à fait propre dans la mesure où son objet – l’étude des mécanismes physiologiques qui conditionnent le comportement de l’individu aux prises avec son environnement – fait partie nettement des sciences biologiques. Quels fruits la psychophysiologie n’a-t-elle pas retirés, et ce n’est là qu’un exemple, de l’application à l’étude des comportements alimentaires, des modèles typiquement biologiques d’homéostasie (Grossman, 1967)!Il ne faudrait pas en conclure pour autant que l’insertion de la psychophysiologie au cœur des sciences biologiques exclut de son champ d’étude les concomitants subjectifs du comportement, tels qu’ils apparaissent à la conscience, car ils sont parfois essentiels à la compréhension d’une conduite ou d’un mécanisme cérébral: seulement, ils doivent être étudiés non avec l’intention de comprendre la nature du phénomène subjectif sur le plan physiologique, entreprise étrangère à la science, mais dans le dessein « pragmatique » (Pribram, 1965) de découvrir la structure des relations unissant, comme on l’a vu plus haut, « les systèmes matériels d’ordre causal et les systèmes implicatifs de signification » (Piaget, 1967).
psychophysiologie [ psikofizjɔlɔʒi ] n. f.• 1877; de psycho- et physiologie♦ Didact. Étude scientifique des rapports entre l'activité physiologique et le psychisme. — Adj. PSYCHOPHYSIOLOGIQUE , 1877 ; n. PSYCHOPHYSIOLOGISTE , 1891 .
● psychophysiologie nom féminin Discipline scientifique qui cherche à mettre en relation les comportements et, éventuellement, les activités mentales chez l'homme avec les processus physiologiques qui sont supposés leur être sous-jacents.psychophysiologien. f. Didac. étude des rapports entre le psychisme et l'activité physiologique.⇒PSYCHOPHYSIOLOGIE, PSYCHO-PHYSIOLOGIE, subst. fém.Science qui étudie les rapports entre l'activité psychique et l'activité physiologique (en particulier celle du système nerveux). Synon. vieilli psychophysique (v. ce mot A 1). Psychophysiologie normale, pathologique; psychophysiologie du travail; laboratoire de psychophysiologie. Quelques progrès que fasse la psycho-physiologie, elle ne pourra jamais représenter qu'une fraction de la psychologie, puisque la majeure partie des phénomènes psychiques ne dérivent pas de causes organiques (DURKHEIM, Divis. trav., 1893, p. 340). Découvertes de Pavlov sur le réflexe conditionné, qui sont à la base de la psychophysiologie russe actuelle (HUYGHE, Dialog. avec visible, 1955, p. 47).Prononc. :[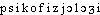 ]. Étymol. et Hist. 1877 psycho-physiologie (LITTRÉ et ROBIN, Dict. de méd., p. 1302a [Baillière] ds QUEM. DDL t. 21); 1902 les méthodes de la psychophysiologie (BARRÈS, Cahiers, t. 2, p. 155). Comp. de l'élém. formant psycho- et de physiologie. Fréq. abs. littér. :19.DÉR. 1. Psychophysiologique, psycho-physiologique, adj. Qui relève de la psychophysiologie. Synon. vieilli psychophysique (v. ce mot A 2). La sensation d'espace est d'ordre psycho-physiologique et (...) l'étroitesse des rues, l'étranglement des cours créent une atmosphère aussi malsaine pour le corps que déprimante pour l'esprit (LE CORBUSIER, Charte Ath., 1957, p. 18). Toute étude expérimentale de psychologie a une dimension nécessairement psychophysiologique (BIROU 1966, s.v. psychophysiologie). V. psychométrique dér. s.v. psychométrie ex. de Amadou. — [
]. Étymol. et Hist. 1877 psycho-physiologie (LITTRÉ et ROBIN, Dict. de méd., p. 1302a [Baillière] ds QUEM. DDL t. 21); 1902 les méthodes de la psychophysiologie (BARRÈS, Cahiers, t. 2, p. 155). Comp. de l'élém. formant psycho- et de physiologie. Fréq. abs. littér. :19.DÉR. 1. Psychophysiologique, psycho-physiologique, adj. Qui relève de la psychophysiologie. Synon. vieilli psychophysique (v. ce mot A 2). La sensation d'espace est d'ordre psycho-physiologique et (...) l'étroitesse des rues, l'étranglement des cours créent une atmosphère aussi malsaine pour le corps que déprimante pour l'esprit (LE CORBUSIER, Charte Ath., 1957, p. 18). Toute étude expérimentale de psychologie a une dimension nécessairement psychophysiologique (BIROU 1966, s.v. psychophysiologie). V. psychométrique dér. s.v. psychométrie ex. de Amadou. — [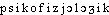 ]. — 1re attest. 1877 (LITTRÉ et ROBIN, Dict. de méd., p. 1302a [Baillière] ds QUEM. DDL t. 21); de psychophysiologie, suff. -ique. — Fréq. abs. littér. : 26. 2. Psychophysiologiste, psycho-physiologiste, subst. Spécialiste de psychophysiologie. Un psychophysiologiste qui affirme l'équivalence exacte de l'état cérébral et de l'état psychologique (BERGSON, Évol. créatr., 1907, p. 354). — [
]. — 1re attest. 1877 (LITTRÉ et ROBIN, Dict. de méd., p. 1302a [Baillière] ds QUEM. DDL t. 21); de psychophysiologie, suff. -ique. — Fréq. abs. littér. : 26. 2. Psychophysiologiste, psycho-physiologiste, subst. Spécialiste de psychophysiologie. Un psychophysiologiste qui affirme l'équivalence exacte de l'état cérébral et de l'état psychologique (BERGSON, Évol. créatr., 1907, p. 354). — [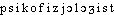 ]. — 1res attest. 1904 psychophysiologiste ou psychophysiologue (Nouv. Lar. ill.), 1907 un psychophysiologiste (BERGSON, loc. cit.); de psychophysiologie, suff. -iste.BBG. — HUSSON (R.). Psychophysiologie du lang. oral, de la lecture et de l'écriture. Nucléus. 1967, n° 1, pp. 6-21; n° 2, pp. 120-132. — QUEM. DDL t. 20.psychophysiologie [psikofizjɔlɔʒi] n. f.ÉTYM. 1877, Littré-Robin; de psycho-, et physiologie.❖♦ Didact. Étude scientifique des rapports entre l'activité physiologique et le psychisme (⇒ Psychophysiologique). || Psychophysiologie générale (étude des fonctions), individuelle…, appliquée (psychotechnique, éducation, pédagogie, thérapeutique : médecine psychosomatique). || La psychophysiologie étudie le système nerveux, l'encéphale (écorce et base ⇒ Cerveau), les hormones… || Psychophysiologie du langage, de l'activité électrique (cit. 1) du cerveau… — REM. On écrit aussi psycho-physiologie.0 La psycho-physiologie est une science, elle n'est pas une philosophie, et précisément parce qu'elle exclut toute hypothèse métaphysique, elle est compatible avec toutes. Qu'il accepte comme une donnée de sens commun la dualité du corps et de l'esprit, ou qu'il suppose que celui-ci n'est qu'un épiphénomène, le premier devoir du psycho-physiologiste est d'aborder l'objet de ses études sans se laisser influencer par des préférences intimes.Jean Delay, la Psycho-physiologie humaine, p. 6.➪ tableau Noms de sciences et d'activités à caractère scientifique.❖DÉR. Psychophysiologique, psychophysiologiste.
]. — 1res attest. 1904 psychophysiologiste ou psychophysiologue (Nouv. Lar. ill.), 1907 un psychophysiologiste (BERGSON, loc. cit.); de psychophysiologie, suff. -iste.BBG. — HUSSON (R.). Psychophysiologie du lang. oral, de la lecture et de l'écriture. Nucléus. 1967, n° 1, pp. 6-21; n° 2, pp. 120-132. — QUEM. DDL t. 20.psychophysiologie [psikofizjɔlɔʒi] n. f.ÉTYM. 1877, Littré-Robin; de psycho-, et physiologie.❖♦ Didact. Étude scientifique des rapports entre l'activité physiologique et le psychisme (⇒ Psychophysiologique). || Psychophysiologie générale (étude des fonctions), individuelle…, appliquée (psychotechnique, éducation, pédagogie, thérapeutique : médecine psychosomatique). || La psychophysiologie étudie le système nerveux, l'encéphale (écorce et base ⇒ Cerveau), les hormones… || Psychophysiologie du langage, de l'activité électrique (cit. 1) du cerveau… — REM. On écrit aussi psycho-physiologie.0 La psycho-physiologie est une science, elle n'est pas une philosophie, et précisément parce qu'elle exclut toute hypothèse métaphysique, elle est compatible avec toutes. Qu'il accepte comme une donnée de sens commun la dualité du corps et de l'esprit, ou qu'il suppose que celui-ci n'est qu'un épiphénomène, le premier devoir du psycho-physiologiste est d'aborder l'objet de ses études sans se laisser influencer par des préférences intimes.Jean Delay, la Psycho-physiologie humaine, p. 6.➪ tableau Noms de sciences et d'activités à caractère scientifique.❖DÉR. Psychophysiologique, psychophysiologiste.
Encyclopédie Universelle. 2012.
